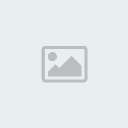Invité
Invité
![[Training solo] Découverte des pouvoirs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) |  Sujet: [Training solo] Découverte des pouvoirs Sujet: [Training solo] Découverte des pouvoirs ![[Training solo] Découverte des pouvoirs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Jeu 15 Déc - 22:53 Jeu 15 Déc - 22:53 | |
| NB : Ceci est un post de transition entre l'histoire de Toulouse telle que je l'ai écrite dans la fiche et le début en RP. L'histoire n'est pas faite de victoires ou de défaites momentanées, mais bien des grands mouvements qui entraînent des peuples entiers vers la gloire ou la destruction.
Nous sommes au 19ème siècle. La France vit un phénomène surprenant : une coalition entre les opposants à l'intérieur et ceux à l'extérieur du système, à travers un programme commun. Leur but ? Elargir le pays légal, à savoir le corps électoral. Est lancée une campagne de banquets, qui vit un grand succès au cours de l'été 1847. Entre 1847 et 1848, cette campagne eut lieu dans la France entière, tenue par des réformateurs qui s'opposaient au gouvernement conservateur de François Guizot, ministre de Louis-Philippe depuis 1840. Le 25 décembre 1847, la campagne est interdite, mais l'absence de réformes la relance. Progressivement, le discours se radicalise, les Républicains deviennent dominants. La coalition se lézarde et les modérés prennent peur, car, s'ils ont une volonté d'élargir le corps électoral, ils veulent tout de même conserver Louis-Philippe. À partir du début 1848, Guizot profite de la division pour réprimer, pensant que c'est le moment d'intervenir.
Le 14 février 1848, le gouvernement interdit le banquet prévu pour le 19 ; suit un appel à manifester le 22 février, place de la Madeleine. L'armée est mobilisée. La manifestation provoque un afflux d'ouvriers et d'étudiants venus des faubourgs de l'Est et du quartier Latin, qui se dirigent vers la place de la Concorde, où se trouve la Chambre des Députés. La journée se déroule dans un rapport de force qui fait un mort. Le jour suivant, le 23 février, il y a de plus en plus de manifestants. Le gouvernement envisage de faire appel à la Garde Nationale, mais celle-ci bascule du côté de la Révolution, alors qu'elle avait semblé au cours de la décennie 1830 être l'âme du régime et avait réprimé bien des émeutes. Des barricades sont dressées. Les soldats refusent de tirer sur le peuple. Dans une volonté de calmer le jeu, Louis-Philippe annonce qu'il se débarrasse de Guizot et nomme un nouveau premier ministre : Molé. Le départ de Guizot plaît aux français, et, le 23 au soir, les choses semblent se calmer. Mais la foule se rend au boulevard des Capucines, lieu de son ministère, pour narguer Guizot. Les gardes s'affolent, un coup de feu part, puis une fusillade. Seize morts. C'est la fusillade du Boulevard des Capucines. Les manifestants relancent le mouvement révolutionnaire, les cadavres sont mis sur des charrettes qui font le tour de Paris pendant la nuit. C'est un appel ambulant à la révolte ! De nouvelles barricades sont levées, et, au matin du 24, Paris brûle sous le feu de la révolution ! Les concessions de Louis-Philippe sont insuffisantes et son maréchal, Bugeaud, ne parvient pas à récupérer Paris. Les troupes peinent à pénétrer dans la capitale. Il ne reste qu'une seule force fidèle au roi : les gardes municipaux.
Mais rien n'empêche la foule d'entrer aux Tuileries après la destruction du Château d'Eau d'où tiraient les gardes municipaux. Louis-Philippe abdique. C'est la victoire de la République, proclamée le 24 février 1848. L'année 1848 devait voir l'Europe à feu et à sang, déchirée par le Printemps des Peuples, et par le triomphe de la Réaction.
Revenons sur certains de ces évènements dans le détail. Le 24 février, à une heure de l'après-midi, les émeutiers font irruption aux Tuileries fraîchement quittées par ses habitants. Au coin des rues, des hommes haranguent le peuple. Ce jour est un grand jour ! C'est la fin de la monarchie, sa mort. La royauté en France explose comme les bouteilles sur les pavés, en tessons colorés étalés au milieu de la voie, qui crissent et éclatent sous les chaussures de la foule. Paris est dévoré par les barricades ; détruit par le peuple qui arrache, renverse, brise, casse, frappe. Les groupes en armes se répandent dans les rues comme des serpents qui glissent sur la terre meuble. Cris et hurlements résonnent dans le vacarme pourtant déjà assourdissant de la révolte. Cris, mais hourras aussi, et tambours qui battent la charge. On se croirait dans un film. Un film aux effets spéciaux d'un réalisme encore jamais vu, mais c'est comme si les morts allaient ouvrir d'un instant à l'autre les yeux, comme si le sang qui recouvre les blessés n'était qu'un artifice du septième art. Pourtant c'est là, c'est bien là, et les hommes les bras en croix ne se relèveront pas. Ne souriront plus jamais. Le feu monte le long des murs, grignote la pierre, la paille, le bois, le foin. La fumée assombrit le ciel. Eau, sang, terre, verre, poussière, tout se mélange en une boue rougeâtre sur le sol de Paris. Paris qui vit la folie révolutionnaire dont avait rêvé Toulouse. Comprenez-vous, maintenant ? Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de se retrouver dans un Paris ainsi aliéné, dans une telle démence révolutionnaire ? Les balles sifflaient et les combattants se poussent et piétinent et s'entretuent. Et La Marseillaise, ah, La Marseillaise, qui soudain retentit à vos oreilles. Malgré le délire insurrectionaire, la foule s'amuse. On lance le trône à travers la fenêtre. C'est toute la monarchie, tout un pan de l'histoire de France qu'on balance ainsi, par des mains d'un bas peuple qui saccage la demeure royale. Sans doute le palais n'avait-il jamais connu autant de monde et, en tout cas, certainement pas aussi peu noble ! Toulouse avance plutôt lentement, émerveillée par ce qui se déroule sous ses yeux. La joie du peuple se ressent. Elle la sent jusqu'au cœur de ses entrailles, jusqu'au fond de son ventre. Toute cette canaille, ces délinquants, ces enfants capricieux du peuple qui bondent les chambres des princesses, volent leurs habits et leur maquillage, lancent à la suite du trône leurs instruments de musique et leurs meubles. Certes, elle est bien loin l'image du peuple sauveur de la France. Ce ne sont ici que des brutes et des hommes rendus choses par leurs actions. C'est une masse anonyme et indistincte qui toutefois a quelque chose de splendide et de magnifique. C'est le désordre de la victoire ! C'est l'avènement d'une nouvelle ère ! La fin d'une époque ! La foule a un caractère négatif, dangereux, les symboles sont dégradés car utilisés par la canaille, mais Toulouse, elle, trouve que c'est le plus beau spectacle du monde. Cette apothéose du vandalisme, cette inquiétude que dégagent les poitrines haletantes du nombre et de la multitude, ce rythme vif au fond sonore extrême et frénétique, ces prostituées qui jouent à la reine, ce peuple infantile, cette scène aux contrastes, cette ironie de la situation dans l'opposition entre raffinement et bassesse… Tout plaît à Toulouse dont l'engouement pour la magie que dégagent la sueur et la transpiration et la barbarie de ces hommes à peine plus hommes que des sauvages est surprenant. Les Tuileries ravagées vivent un carnaval populaire, dont la connotation est bien éloignée de l'épopée de 1789. C'est la crapule qui assouvit ses pulsions, qui accomplit sa vengeance inquiétante. La révolution prend un caractère sombre que seuls les romanciers pourront décrire et qu'omettront les historiens. Et elle, qui n'a même pas pu mener sa thèse à bien, elle en fait partie ! Elle fait corps avec l'histoire, l'Histoire, elle assiste à cette peu glorieuse représentation du peuple, à ces heures sans grandeur, à cette violence d'un peuple sans cervelle. La scène est accablante de stupidité. C'est la dénonciation de la sottise et de la naïveté du peuple. Voilà pourquoi l'Empire s'imposera à nouveau ! Le peuple n'est qu'un jouet entre les mains des leaders de l'opposition. Il y a quelque chose de fantastique dans la possibilité qu'il y a là d'admirer à quel point on peut le manipuler, à quel point la politique en fait ce qu'elle veut. C'est une histoire de la sociologie qui se déroule sous ses yeux. Elle en fait partie, elle fait corps avec l'histoire. Et la joie et la fureur du peuple ont quelque chose de malsain qui la fascine. L'idéal de liberté du peuple s'est dégradé en caprice au caractère dangereux, naïf, enfantin, si peu héroïque ou courageux. Ces hommes-là, ils ne sont ni admirables, ni respectables. Quel honneur, quelle grandeur y a-t-il à détruire ainsi des meubles qui ne sont pas responsables des malheurs de la France, ni de la crise économique, ni du corps électoral trop restreint. Quelle grandeur y a-t-il à saccager un palais vide ? Mais à côté de ce peuple sans grandeur morale, qu'ils apparaissent encore plus grands, encore plus formidables, ces hommes de l'histoire qu'elle admire et vénère. Elle est heureuse, elle est bien. Elle voudrait ne jamais rouvrir les yeux. Elle flotte sur la mer du temps, sans but précis, simplement librement emportée par les flots paisibles, ramenée de temps en temps par des vagues qui la ramènent tendrement vers la plage du présent. Mais il faut sortir de sa rêverie. Alors elle rouvre les yeux. Elle les rouvre, et… Rien. Elle est toujours là, au milieu du peuple en révolte, de la destruction des Tuileries. C'est comme si le passé avait remplacé le présent. Un homme passe en courant, la bouscule. Elle vacille. À côté d'elle, une vitre éclate. C'est le chaos. Un morceau de verre lui érafle la joue. C'est là qu'elle commence à comprendre. Au moment précis où une goutte de sang, une unique goutte de sang, perle de sa peau et touche le sol. Le monde semble se figer. Puis s'effondre en carrés colorés qui chutent dans le gouffre béant de l'infini.
Elle est toujours là où elle était avant de partir dans ses pensées en direction de temps oubliés. Allongée dans l'herbe. Même visage que le matin, même cheveux roses, même vêtements. En l'occurrence, des escarpins en veau verni perlé (Louis Vuitton, défilé automne/hiver 2011-2012, 650 euros, chacun ses valeurs) avec bride élastique, en veau verni également, dont le nœud est bien sûr fait à la main. Plateforme interne (pour plus de confort !), semelle intérieure en cuir, molletonnée. Talons : onze centimètres. Couleur : vert sombre, sauf la bride, qui est noire. Bout arrondi, nœud délicat et talon d'inspiration rétro. L'une de ses paires favorites. Assortie bien sûr à une robe noire. À savoir une robe en crêpe-mousseline de polyester, vaporeuse et transparente, bustier et bas superposés, doublure opaque. Bretelles ajustables, bustier à baleines souples, bas évasé, bande agrippante à l'intérieur. Ne pas laver à plus de trente degrés si vous tenez aux cent euros que la robe en question vous a coûtés. Idéale pour une soirée. Mais cela n'entrait pas en considération dans l'obsession de la mode qu'avait Toulouse. Vous vous habillez convenablement seulement lorsque vous sortez en boîte vous ? Ainsi donc habillée, Toulouse se redressa brusquement. Cette fois, c'était différent. Son imagination n'avait pas simplement pris son élan vers des horizons lointains, l'emportant vers un monde qu'elle aurait aimé connaître, vers des endroits qu'elle avait tellement souhaité voir… Elle toucha sa joue endolorie. Endolorie, mais parfaitement lisse. La douleur existait encore, mais sur sa peau la blessure n'était plus. Le galop de sa rêverie avait eu quelque chose de réel. L'univers autour d'elle n'avait été que produit de son esprit, mais la douleur, elle, avait existé pour de bon. Le mot s'imposa. Illusion. La tentation de retenter l'aventure était forte, très forte. Il n'aurait fallu qu'un abandon total à ce que son imagination pouvait produire de plus réaliste, un évènement historique dont elle avait étudié tous les détails.
Il n'y a qu'un secret pour mener le monde, c'est d'être fort, parce qu'il n'y a dans la force ni erreur, ni illusion ; c'est le vrai, mis à nu.
18 juin 1815. Cette date vous dit quelque chose ? Nous sommes près de l'achèvement des Cents Jours qui virent le retour de Napoléon entre ses deux abdications, intermède entre les deux Restaurations des Bourbons. Aujourd'hui se joue l'une des plus grandes pièces de théâtre de l'histoire : la bataille de Waterloo. Les forces en présence : le général anglais Wellington, le maréchal prussien Blücher, et face à eux, l'Armée du Nord de l'empereur Napoléon Ier. On pourrait décrire cette bataille dans le détail mais mille mots n'y suffiraient pas. Être plongé en plein cœur de cet évènement mémorable qui causa la chute de l'un des hommes qui s'approcha le plus de la conquête de l'Europe n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez lire dans les livres. D'abord, il y a la boue dans laquelle les roues des charrettes se coincent. Il y a les cadavres, étendus sur le gazon. C'est la réalité de la guerre. Les morts. Ils sont simplement posés là, comme disposés pour une photographie. Leur figure est déjà émaciée, et vous laisse glacé d'horreur. Qu'ils sont sales, ces morts, souillés par la boue et le sang, dépouillés de leurs armes, de leurs bottes, de leur veste. Ils sont criblés de balles. Parfois, pour l'un d'entre eux, c'est le visage que l'une de ces balles a défiguré. Elle lui entre par un côté et ressort par la joue opposée. Souvent, ses yeux, ou un seul d'entre eux dans certains cas, sont restés ouverts. Et il vous fixe d'un air hideux de reproche. Il a dix-huit, dix-neuf ou vingt ans et ses parents ne le verront jamais rentrer. Pleine de dégoût, Toulouse embrassa du regard les alentours. Ce qui frappait surtout, c'était le bruit des canons. Tout n'est que chaos et confusion. Tout ce que l'on voit d'une bataille est là. À savoir ? Rien. Les entrailles retournées, Toulouse, émue parce qu'elle savait que, même si elle ne comprenait pas grand-chose à ce qu'elle voyait, elle vivait quelque chose d'à la fois horrible, terrible et grandiose, admirait ces instants majestueux. Le son du canon remplissait l'atmosphère de quelque chose d'indescriptible. Les boulets faisaient voler la terre en mottes sombres, la fumée des batteries s'élevait vers le bleu troublé du ciel. C'était un ronflement qu'émettaient les coups de canon, un ronflement assourdissant et étouffant. Des chevaux éventrés gisaient tout sanglants sur la terre que labouraient les boulets. D'autres bêtes, encore vivantes, tentaient de se relever et de se lancer à la suite de la cavalerie, galopant derrière les généraux comme l'instant d'avant. Leurs pattes s'emmêlaient entre elles et dans leurs propres entrailles qui se vidaient sur le sol boueux, rougeâtre et imbibé. Toulouse aperçut des cavaliers en rouge lancés au trot derrière un officier, probablement un maréchal. Ils pataugeaient dans la boue. Plus loin, on se chargeait d'amputer (couper serait un terme plus exact, il y avait quelque chose de sauvage et de primitif dans la façon dont la lame ôtait le membre déchiqueté) un jeune homme. Des dragons passèrent, portant fièrement leurs casques à crinière. Peut-être se trouvait là l'Empereur lui-même. Tous ces innocents qui mouraient, c'était le fruit de son orgueil. Sur plus de cent mille hommes qui s'étaient trouvés là, dans la boue et le sang, dans tout ce que la guerre a de plus affreux à offrir, c'était un dixième qui étaient morts, un tiers de blessés, et près d'un dixième encore, uniquement dans le camp français cette fois, qui furent faits prisonniers. Et il y avait encore les disparus, avalés par les mystères que suscite une bataille aussi démesurée. Si vous ne l'avez pas vue de vos propres yeux, vous ne l'avez jamais vue.
Il lui semblait sentir encore dans ses cheveux l'odeur âcre de la mort, il lui semblait que son visage était encore couvert de poussières, que ses bottes grossières d'uniforme étaient encore couvertes de boue. Dans son regard bleu étaient imprimées les images terribles des os brisés, des membres déchiquetés, des morts défigurés, de la terre sillonnée par le trajet des boulets qui retombent lorsqu'ils n'ont pas éviscéré un cavalier, et ses oreilles résonnaient encore du bruit des canons. C'était Waterloo dans toute sa vérité, dans tout ce que la bataille pouvait avoir de si affreux, de si prodigieux. Pourtant c'était au Japon qu'elle se trouvait, à des milliers de kilomètres de la Belgique, et le champ de bataille d'une des batailles les plus célèbres du 19ème siècle n'était plus aujourd'hui qu'une vaste pelouse qui n'avait pas gardé les marques des choses affreuses qui s'y étaient pourtant déroulées. Elle se rappelait comme si elle les avait toujours sous les yeux les soldats courbés sur le cadavre d'un de leurs camarades, la galopade de la cavalerie morcelée, les cantinières affolées, et la débandade surtout, qui avait suivi la défaite de l'Empereur. Mais non, elle n'avait plus tout cela sous les yeux. C'était son pays, son présent. Napoléon était mort depuis bien longtemps, rejoignant dans le tombeau ceux à qui il avait coûté la vie, le vent nocturne et l'air frais du matin. La France n'avait cessé d'être une République depuis la chute du neveu du vaincu de Waterloo, Napoléon III, en 1870. Mais elle l'avait sentie sur ses jambes, cette boue ! Elle l'avait humée, cette fumée de l'artillerie ! Tout cela avait existé, dans une autre dimension peut-être, n'importe où. Elle y avait été, pour de vrai. Ce n'était plus le monde inventé dans lequel elle s'enfermait depuis son enfance, c'était quelque chose de presque réel, palpable, sensible. Quelque chose qui touchait tous ses sens, pénétrait par chacun des pores de sa peau, emplissait son nez de milliers d'odeurs, charmait ses yeux de mille images, étouffait ses oreilles de son jusqu'à la surdité, laissait sur sa langue le goût amer du fer et de la bile. Une illusion qui l'enveloppait dans son confortable nuage de sensations et de persuasion. Une illusion perfide qui lui sifflait langoureusement à l'oreille que tout ce qu'elle vivait, voyait, sentait, entendait, goûtait, touchait, aimait, détestait, vomissait, craignait, espérait, rêvait, tout était vrai. Mais cela ne l'était pas. C'était un aperçu d'un autre univers, si différent du sien, si éloigné de ce qu'elle avait connu. Depuis longtemps elle avait pris l'habitude de se réfugier dans quelque chose de parallèle, d'étranger. Elle se voyait princesse de royaumes inconnus sortis de temps immémoriaux, ou fille cachée d'un Dieu de l'Olympe. Mais ça… C'était quelque chose de nouveau et de stupéfiant. Elle pouvait renoncer à ses naïves histoires d'enfant, auxquelles elle aurait dû être bien trop grande pour croire. Elle pouvait s'abandonner à une réconfortante illusion si réaliste qu'elle n'avait qu'à se persuader qu'il s'agissait du réel. Elle n'avait plus à avoir honte de ses enfantillages. C'était un miracle, un prodige, un Don de Dieu, un… Pouvoir.
Le pouvoir de tout modifier souverainement est dans notre volonté.
|
|